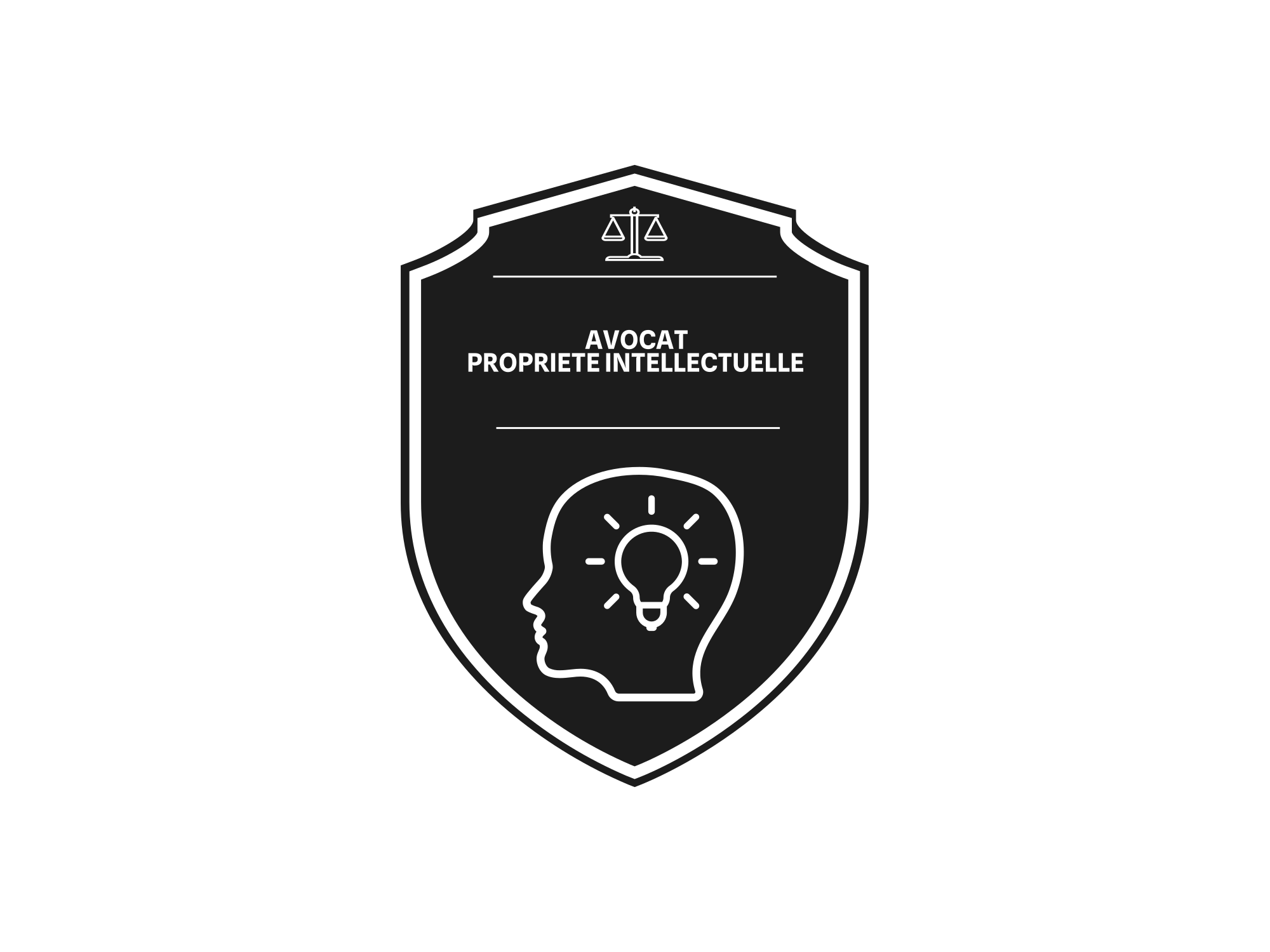Dans le paysage mouvant du droit du travail, les questions d’articulation entre accord d’entreprise et convention collective sont plus que jamais au centre des débats en 2025. Depuis les réformes successives, notamment celles portées par la loi El Khomri et les ordonnances Macron, la hiérarchie des normes a connu des modifications significatives. Le principe longtemps établi de la faveur, qui garantissait que les accords d’entreprise ne pouvaient être moins favorables que les conventions collectives, est désormais nuancé voire remis en cause dans plusieurs domaines. Cette évolution soulève une interrogation majeure : quels sont les effets concrets de cette primauté révisée de l’accord d’entreprise sur les droits et protections des salariés ? Les entreprises disposent d’une latitude élargie pour adapter les conditions de travail, mais à quel prix pour la sécurité juridique et sociale des collaborateurs ? L’équilibre entre souplesse économique et protection sociale reste l’enjeu fondamental du dialogue social en 2025.
Évolution de la hiérarchie des normes en droit du travail : accorder moins favorable qu’une convention collective en 2025
Depuis plusieurs décennies, la hiérarchie des normes en droit du travail français repose sur un empilement structuré, depuis la Constitution et les traités internationaux jusqu’aux accords d’entreprise, en passant par le Code du travail et les conventions collectives. Cette architecture garantie une protection forte du salarié grâce au principe de faveur, selon lequel la norme la plus avantageuse s’applique. Jusqu’alors, un accord d’entreprise ne pouvait déroger qu’en mieux aux dispositions d’une convention collective. Cependant, depuis les années 2010 et avec la réforme majeure de 2017, ce cadre a évolué.
La loi El Khomri (2016) avait déjà introduit des dérogations ciblées, notamment sur le temps de travail, en permettant à l’accord d’entreprise de primer sur des accords de branche pour certaines modalités comme :
- Le taux majoré des heures supplémentaires
- La modulation et l’aménagement du temps de travail
- Le travail les jours fériés
- Les temps de repos quotidiens
Ces mesures avaient pour objectif d’adapter les conditions de travail aux réalités spécifiques de chaque entreprise.
Le véritable tournant est venu avec les ordonnances Macron de 2017. Elles instaurent la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, même lorsque les clauses sont moins favorables aux salariés, sauf exceptions. Cette réforme a profondément redessiné le paysage de la négociation collective et du dialogue social en donnant plus de poids à la sphère interne à l’entreprise.
En 2025, cette tendance se confirme et s’inscrit dans le droit fil des volontés gouvernementales visant à flexibiliser le droit du travail tout en maintenant un socle minimal protégé. Ainsi, un accord d’entreprise peut désormais prévoir des mesures moins avantageuses que celles prévues par la convention collective, dans la majeure partie des domaines, sous réserve de respecter les minima imposés par la loi.
| Niveau normatif | Avant 2017 | Depuis 2017 |
|---|---|---|
| Hiérarchie entre accord d’entreprise et convention collective | Convention collective prime sauf accord plus favorable en entreprise | Accord d’entreprise prime même s’il est moins favorable sauf exceptions |
| Principe de faveur | Appliqué strictement | Assoupli, limité à certains domaines protégés |
| Domaines « verrouillés » sans dérogation | Peu nombreux | 13 matières (salaires minima, égalité, classifications, etc.) |
Malgré ces évolutions, le Code du travail continue de fixer un plancher obligatoire dans certains domaines sensibles pour éviter la remise en cause des droits fondamentaux. Par exemple, les salaires minima garantis, l’égalité hommes-femmes et les classifications professionnelles restent des territoires protégés. Dans ces cas, un accord d’entreprise ne peut pas s’écarter de façon défavorable à la convention collective.
Différences clés entre accords d’entreprise et conventions collectives en 2025
- Origine et application : La convention collective est négociée au niveau de la branche professionnelle et vise à harmoniser les conditions de travail pour un secteur entier. L’accord d’entreprise est spécifique à une société ou à un groupe et répond à des besoins concrets et locaux.
- Flexibilité : L’accord d’entreprise bénéficie désormais d’une souplesse accrue pour déroger sur de nombreuses matières, facilitant des adaptations rapides aux contraintes économiques.
- Force obligatoire : L’accord d’entreprise prévaut en principe sur la convention collective sauf interdiction explicite, renforçant le poids de la négociation interne.
- Contrôle juridique : Les accords doivent respecter l’ordre public social et les clauses impératives, sans quoi ils sont susceptibles de contestation auprès des tribunaux.

Les mécanismes juridiques pour contester un accord d’entreprise moins favorable en 2025
Face à un accord d’entreprise moins avantageux que la convention collective, les salariés disposent de plusieurs garanties légales et procédures de recours afin de protéger leurs droits. Ces mécanismes s’inscrivent dans le cadre plus large du dialogue social, visant à équilibrer les rapports entre employeurs et employés.
Voici les principales voies de contestation prévues :
- Action en nullité devant le tribunal judiciaire : Les organisations syndicales ou les salariés peuvent saisir le tribunal pour contester un accord d’entreprise. Les motifs fréquemment invoqués incluent :
- Le non-respect des règles formelles de négociation
- L’atteinte aux libertés fondamentales des salariés
- La violation des matières où l’accord d’entreprise ne peut déroger défavorablement à la convention collective
Ces recours nécessitent un suivi rigoureux des délais légaux. Par exemple, une action en nullité doit être engagée dans un délai de deux mois après la publication ou la notification de l’accord. Par ailleurs, si la contestation n’aboutit pas à l’annulation, cela n’empêche pas le relancement de négociations pour une amélioration contractuelle.
Dans la pratique, la vigilance des représentants du personnel est cruciale. Les délégués syndicaux et membres du Comité Social et Économique (CSE) constituent des acteurs de premier plan pour contrôler la négociation et défendre les intérêts collectifs.
| Procédure | Délai | Effet principal |
|---|---|---|
| Action en nullité judiciaire | 2 mois après notification | Annulation de l’accord si motif validé |
| Saisine inspection du travail | Variable | Contrôle et recommandations possibles |
| Dénonciation d’accord collectif | Selon clauses d’accord | Ouverture de négociation et suspension de l’accord |

Le rôle central des représentants du personnel dans la négociation et la surveillance des accords d’entreprise
Les représentants des salariés sont au cœur du dispositif de négociation collective. Leur expertise permet de garantir que les accords d’entreprise ne portent pas atteinte injustement aux droits des travailleurs, en particulier depuis la montée en puissance des accords moins favorables autorisés par la réforme 2025.
Leurs missions principales sont :
- Analyse comparative : Passer en revue les clauses négociées par rapport à celles de la convention collective pour détecter toute baisse de protection.
- Information et consultation : Assurer la transparence auprès des salariés sur les contenus et impacts des accords proposés.
- Recueillir et défendre les attentes : Consolider les revendications des salariés en vue de négociations équitables.
- Veille juridique : S’informer sur les évolutions légales pour anticiper les risques liés aux nouvelles négociations.
Il faut noter que selon la taille et l’organisation de l’entreprise, la négociation peut impliquer :
- Les délégués syndicaux dans les entreprises avec syndicat implanté
- Les membres élus du CSE, en particulier dans les entreprises entre 11 et 50 salariés sans délégués syndicaux selon les règles spécifiques en vigueur
- Les salariés mandatés ou consultation par référendum dans les petites structures
Le développement d’une culture du dialogue social est un levier essentiel pour adapter durablement les conditions de travail tout en préservant les droits collectifs. Ainsi, une négociation bien conduite n’est pas qu’une contrainte, mais aussi une opportunité stratégique pour l’entreprise et ses collaborateurs.
Techniques et stratégies de renégociation pour corriger un accord d’entreprise moins favorable que la convention collective
Confrontés à des accords d’entreprise plus restrictifs, les représentants des salariés peuvent mettre en œuvre diverses approches pour obtenir des améliorations et rétablir un équilibre plus favorable.
Parmi les stratégies couramment utilisées :
- Demande ciblée de révision : Identifier précisément les clauses les plus défavorables et demander leur modification plutôt que la renégociation totale de l’accord.
- Utilisation des négociations annuelles obligatoires (NAO) : Profiter des temps forts de la négociation collective pour discuter des rémunérations, temps de travail, égalité professionnelle et autres sujets sensibles.
- Négociation d’accords plus globaux : Engager des discussions larges intégrant plusieurs thématiques pour favoriser des compensations sur certains points plus difficiles.
- Mobilisation collective : Organiser des actions pour sensibiliser l’employeur aux attentes et engager un dialogue constructif face à un rapport de force
Une préparation soignée est indispensable, reposant sur une connaissance fine des textes, des décisions de justice, mais aussi des conditions économiques spécifiques à l’entreprise. Cette démarche valorise l’importance d’un dialogue social dynamique et informé, indispensable en 2025 aux bonnes relations professionnelles.
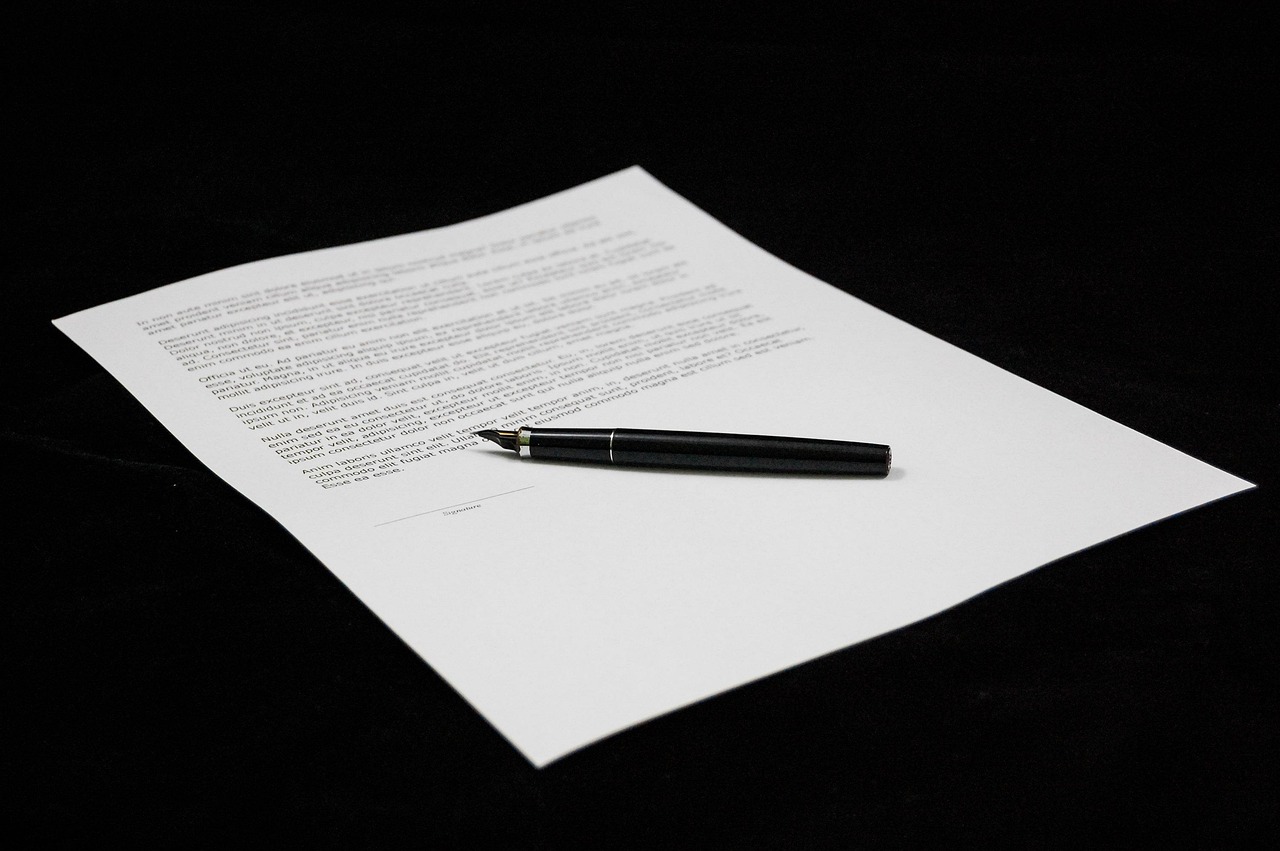
Conséquences pratiques pour les salariés : vigilance face à la primauté renforcée de l’accord d’entreprise
La montée en puissance de l’accord d’entreprise dans la hiérarchie des normes comporte plusieurs implications majeures pour les salariés. Il est essentiel de comprendre les mécanismes et les limites de cette évolution afin de mieux faire valoir ses droits.
Voici les principaux impacts :
- Moins d’application automatique du principe de faveur : L’accord d’entreprise s’impose souvent, même s’il est moins avantageux que la convention collective, ce qui bouleverse les pratiques antérieures.
- Cumul d’avantages : Généralement, il n’y a pas de cumul possible entre l’accord d’entreprise et la convention collective pour des avantages similaires. L’accord applicable est celui qui prime selon la hiérarchie en vigueur.
- Droit d’option individuel : Dans certains cas, le salarié peut choisir (dans un délai restreint) d’appliquer l’ancien avantage ou le nouveau, si cette option est prévue dans l’accord.
- Nécessité d’une information continue : Les salariés doivent se tenir informés des changements contractuels et être accompagnés, notamment par leurs représentants syndicaux.
Il ne faut pas sous-estimer les conséquences sur le terrain : un accord moins favorable peut affecter les salaires, les durées de congés, les modalités de travail et les garanties sociales. D’où l’impératif d’une vigilance renforcée et d’une connaissance actualisée des dispositifs applicables, rendue possible notamment grâce à des ressources disponibles comme sur le site bo.avocat-propriete-intellectuelle.fr.
| Domaine impacté | Risques liés à un accord moins favorable | Conséquence pour le salarié |
|---|---|---|
| Salaires minima | Restriction non autorisée dans le cadre légal | Protection garantie par la loi |
| Temps de travail | Modulation et aménagement possibles | Horaires modulables et adaptation des repos |
| Primes et avantages | Réduction ou suppression possible | Perte de revenus complémentaires |
Principales matières où l’accord d’entreprise ne peut être moins favorable qu’une convention collective
| Matières | Exemples concrets |
|---|